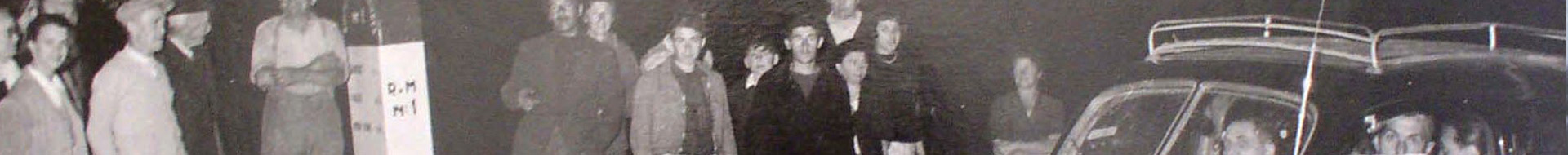4 questions sur Cahors Mundi,
les Citoyens du monde et la Route sans Frontières N°1

Pourquoi une route sans frontières ?
Il y a un peu plus de sept décennies, en pleine guerre froide, la menace d’un conflit atomique plane sur le monde.
Des hommes et des femmes épris de paix entendent donner vie au vœu de Victor Hugo : « avoir pour patrie le Monde et pour nation l’Humanité. » À l’image de Garry Davis, pilote de bombardier traumatisé par la Seconde Guerre mondiale qui a renoncé à sa nationalités États-Unienne, ces femmes et ces hommes se veulent « Citoyens du Monde ».
Leur idéal en action est soutenu par des personnalités aussi diverses qu’Albert Einstein, l’abbé Pierre, Albert Camus, Claude Bourdet ou Vercors. Il est également relayé par Le Canard enchaîné, Le Monde et des journaux issus de la Résistance.
Avec l’ancien militaire de carrière Robert Soulage de son nom de résistant Sarrazac, ils ambitionnent d’entreprendre la mondialisation des territoires, se voulant alors solidaire, humaniste et au service des peuples.
Et Cahors dans cette histoire ?
Le 30 juillet 1949, Cahors est la toute première ville à adopter la Charte de mondialisation, se déclarant liée à la communauté mondiale : elle se veut Cahors du Monde, Cahors Mundi. Les Cadurciens approuvent par un vote la décision du conseil municipal et de son maire, Jean Calvet.
Les 24 et 25 juin 1950, les Journées de la mondialisation se tiennent à Cahors, en présence du tout récent Prix Nobel de la paix, Lord Boyd Orr. Le premier tronçon de la Route mondiale N° 1 est alors ouvert.
Ses bornes emblématiques sont inaugurées à Cahors, au pont Valentré, puis tout au long de la rivière Lot, jusqu’à Tour-de-Faure, au pied de Saint-Cirq-Lapopie.
Quelles sont les valeurs de la citoyenneté mondiale ?
Réunissant symboliquement les deux blocs opposés, l’Ouest et l’Est, ces bornes portent d’un côté le nom de New York et, de l’autre, celui de Moscou. La commune de Revel, où est né Vincent Auriol, le président de la République, se veut aussi mondialisée, de même que Königswinter, proche de Petersberg où siège alors le haut commandement des forces d’occupation alliées en Allemagne de l’Ouest. En évoquant le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et l’assassinat de Gandhi à New Delhi, les Citoyens du Monde entendent conjurer la menace d’une guerre nucléaire plus terrible encore.
C'est cette Route sans frontières, qui a l’ambition de faire le tour de la Terre pour rassembler les êtres humains dans une communauté de destin et une fraternité universelle, que le poète André Breton, découvrant alors Saint-Cirq-Lapopie où il choisira de passer tous les étés, qualifie de « seule route de l’espoir ».
Pourquoi la route s’arrête-t-elle à Saint-Cirq-Lapopie ?
Il était initialement prévu que le tracé de la route fasse le tour du monde. Malheureusement, comme pour confirmer cette remise en question des pouvoirs et des blocs, le soir même de l’inauguration de la Route sans frontières éclate la guerre de Corée. Le 25 juin 1950, les troupes de Corée du Nord franchissent le 38e parallèle qui, depuis 1945, marque la ligne de démarcation militaire du pays entre le Nord, sous influence soviétique, et le Sud, sous influence américaine. L’Humanité se trouve à nouveau sous la menace d’un conflit planétaire, celui justement que les mondialistes voulaient éviter. Las, la belle épopée s’arrête net !